
Maroun Eddé a enquêté plusieurs années durant dans les coulisses du pouvoir et de l’administration pour produire le bilan global des réformes successives de l’État. Il en a résulté un ouvrage accablant pour les décideurs politiques français, dont les mauvais choix, ces dernières décennies, ont conduit au dérapage des finances publiques et au démantèlement de l’État lui-même. En plein débat sur le vote du budget 2025, l’essayiste rappelle que les coupes budgétaires dogmatiques n’ont jamais résolu la question des déficits, encore moins celle de l’efficacité de l’action publique.
Propos recueillis par Ella Micheletti et Pierre-Henri Paulet.
Voix de l’Hexagone : Vous vous êtes intéressé en profondeur au fonctionnement de l’État, à son budget, à son périmètre d’action, à son histoire aussi. Il en a résulté un essai particulièrement percutant, La Destruction de l’État paru en octobre 2023 (Éd. Bouquins). Qu’est-ce qui vous a conduit à ces recherches et comment les avez-vous menées ?
Maroun Eddé : Ma démarche a commencé avec la prise de conscience qu’il n’y a pas eu véritablement de bilan global portant sur les différents « slogans » imposés depuis vingt ou trente ans au sujet de l’État. Depuis une trentaine d’années, il existe une forme de consensus sur le fait qu’il est nécessaire de privatiser, externaliser, soumettre les services publics à des impératifs de rentabilité, aller plus loin dans la libéralisation européenne, et supprimer des postes de fonctionnaires pour réduire les dépenses publiques. Le consensus s’est forgé autour de ces éléments-là qui, initialement, étaient issus d’une certaine idéologie et qui sont devenus de purs slogans. La première chose qui m’a marqué a été d’observer des résultats absolument contraires à ceux qui avaient été promis depuis les années 1990. On nous promettait que ces « réformes » allaient déboucher sur un État plus efficace et moins coûteux, on se retrouve aujourd’hui avec un État moins efficace et plus coûteux. Pourtant, les politiques poursuivent dans la même voie. Pourquoi ? Qui a intérêt à ce qu’on continue à démanteler notre État, nos administrations, nos services publics, notre industrie ?
J’ai voulu faire le bilan de ce processus. On entend beaucoup de cris d’alerte sectoriels (les enseignants qui déplorent le manque de moyens et la chute du niveau des élèves, les psychiatres qui écrivent des livres sur l’effondrement de la psychiatrie française…) Mais je n’avais pas trouvé de synthèse globale de ce qui a conduit le pouvoir au sommet de l’État à prendre ces décisions, de l’échec produit et surtout de pourquoi ce mouvement persiste. J’ai réalisé cette enquête en mêlant mes expériences personnelles au niveau ministériel et dans des think tanks assez proches de partis politiques ou de cercles du pouvoir avec des entretiens menés au sein de l’État, aussi bien au niveau des dirigeants que dans les différents services publics. J’ai interrogé des préfets, des diplomates, des fonctionnaires du ministère des Finances à Bercy, des agents actuellement en poste dans les ministères.
VdH : Partout en Europe, singulièrement en France où son rôle historique est majeur, la « réforme de l’État » est à l’ordre du jour. Qu’est-ce que les politiques, de droite comme de gauche, ambitionnent sous ce vocable ?
M. E. : L’expression a été galvaudée dans le sens où il y aurait beaucoup à réformer dans l’État. Effectivement, l’État, comme toutes les institutions, a vocation à évoluer et à être réformé, surtout dans un monde où les enjeux évoluent assez vite. Des choses pourraient être changées. Malheureusement, le vocable même de « réforme de l’État » a fini par être utilisé avec le sous-entendu implicite que l’État lui-même représentait le problème et qu’il fallait donc le réformer dans le sens de son amaigrissement, sans nécessairement se poser la question de savoir à quoi sert cet État, ce qu’il nous apporte réellement et où est-ce qu’il faudrait l’amaigrir. La réforme de l’État est devenue très rapidement un terme populiste de la part d’élites souvent libérales ou ultra-libérales. Le dernier qui a repris à son compte, dans sa langue, les termes de « réforme de l’État » est Elon Musk avec son DOGE (Department Of Governement Efficiency) composé de gens… qui ne connaissent pas l’État. Il y a derrière cela l’idée que quelques personnes dans le privé sont extrêmement efficaces, que l’État constitue comme disait Reagan non pas la solution mais le problème et donc qu’on va résoudre tout problème en faisant disparaître l’État ou tout du moins en parvenant à un « État plateforme » – vision plus macronienne – avec le moins de fonctionnaires possibles. On observe une instrumentalisation, marquée par une forme de rejet de l’État et du fonctionnaire, qui a conduit à saboter le cœur de nos services publics sous prétexte d’obtenir davantage d’efficacité économique.
VdH : Un État qui serait une entreprise comme une autre ?
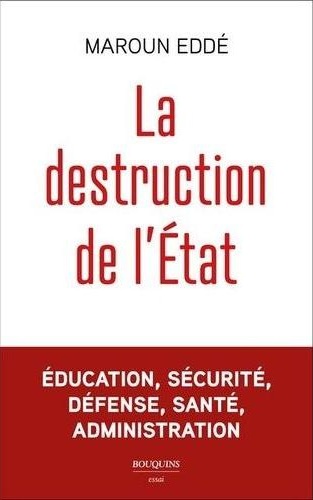
M. E. : C’est une vaste question ! Il faut se méfier des dirigeants qui prétendent qu’il faudrait gérer l’État comme une entreprise. Le plus souvent, ils n’ont eux-mêmes aucune idée de la manière dont est gérée une entreprise. Ce sont des personnes qui n’ont souvent pas d’expérience dans le secteur privé ou bien qui ont une expérience superficielle dans des cabinets de conseil ou de communication, pas dans de véritables organisations. Ils vont donc promouvoir une image fantasmée de ce que devrait faire le privé et finissent même parfois par assimiler « le privé » au modèle de la start-up, ce qui n’a aucun sens… La start-up est en effet le forme zéro d’une organisation, dont certains prétendent qu’il faut s’en inspirer pour la plus complexe des organisations qu’est l’État.
Comme j’ai pu l’expliquer dans mon ouvrage, se pose avant tout la question : « Qu’est-ce que l’État ? » Or, on a menti aux Français sur ce qu’était l’État et sur ce qu’était un fonctionnaire. Quand on parle de « réforme de l’État », on cible en réalité les formalités administratives. L’image véhiculée est celle du fonctionnaire travaillant de 10 à 16 heures sur des formulaires auxquels personne ne comprend rien. Mais à travers les promesses de suppressions de postes de fonctionnaires sous prétexte de « réforme de l’État », on s’est attaqué en réalité aux infirmiers, aux policiers, aux magistrats. Les mêmes acteurs qui y étaient favorables vont déplorer vingt ans plus tard le manque d’enseignants, de personnes qualifiées dans la police ou la justice, alors qu’ils ont initié ces politiques et les poursuivent aujourd’hui. Il n’y a pas eu de travail suffisamment sérieux sur ce qu’est l’État, sur ses prérogatives, sur le rôle qu’il doit jouer au XXIe siècle pour éviter un déclassement du pays. Ces enjeux stratégiques ne sont souvent pas pris en compte, y compris de la part d’institutions comme la Cour des comptes, qui sont censées s’y intéresser.
VdH : Vous venez d’y faire allusion : on associe généralement la réforme de l’État à l’exemple du privé. L’État est-il vraiment, comme nous l’énoncent économistes, éditorialistes et politiques, incapable de bonne gestion et surtout bien moins efficace que le secteur privé en matière de recherche et innovation ?
M.E. : L’État serait-il incapable de bonne gestion, de bonne organisation et d’innovation ? Les deux ou trois cents dernières années de l’histoire française tendent à prouver l’inverse. L’État nous a conduit aux plus belles réalisations qui font que la France est aujourd’hui un pays développé, ne serait-ce que par les infrastructures et nos innovations. Les autoroutes, le TGV, le réseau téléphonique, le métro, notre système hospitalier, nos universités, nos centrales nucléaires et hydroélectriques : nous devons tout cela à l’État, aux investissements publics, à ses capacités de maîtrise d’ouvrage et d’orchestration du secteur privé. Sans oublier les innovations d’origine publique, en agriculture et en agronomie, en médecine, dans l’industrie lourde. On a tendance à trop souvent prendre tout cela pour acquis, sans compter les forces qui ont permis de les faire exister. Idem aux États-Unis, où les principales innovations fondamentales, radicales, qui sont ensuite utilisées par les entrepreneurs privés, viennent de budgets de l’armée américaine, de la DARPA (ndlr : l’agence pour les projets de recherche avancée de défense), de l’État fédéral américain, des États fédéraux qui permettent d’investir sur le long terme dans l’enseignement supérieur, dans la recherche et développement, pour pouvoir parvenir aux innovations que le privé utilisera ensuite pour son compte. Ce qui nous a manqué en France, c’est plutôt un secteur privé suffisamment agile et entreprenant pour reprendre à son compte les innovations fondamentales de la recherche publique ou des plans étatiques.
Par ailleurs, je pense que l’État peut être bien géré. Mais c’est une question de volonté et de responsabilité politique. C’est là que le bât blesse. Il est beaucoup plus facile pour les politiques de rejeter la faute sur l’administration plutôt que de s’interroger sur leurs propres erreurs de gestion. Un PDG dont l’entreprise est mal gérée ne va pas prétendre qu’une entreprise ne peut pas en soi être mal gérée… Non, c’est parce que lui la gère mal ! Et en général, dans ce cas-là, on le remplace et on en met un autre. Il est donc plus facile pour les politiques de remettre la faute sur l’administration, sur les fonctionnaires, sur le nombre de fonctionnaires.
« L’État nous a conduit aux plus belles réalisations qui font que la France est aujourd’hui un pays développé, ne serait-ce que par les infrastructures et nos innovations. »
Prenons l’exemple du ministère de l’Équipement. À l’époque du Général de Gaulle, 120 000 fonctionnaires (ingénieurs, techniciens, ouvriers d’État) y travaillaient et c’était l’un des ministères les mieux gérés. Il a permis de créer nos routes, nos ponts, de participer à l’architecture de nos centrales nucléaires, etc. Aujourd’hui, il a été absorbé par le ministère de la Transition écologique et il ne comprend plus que 50 000 fonctionnaires dont la gestion est beaucoup plus bureaucratique puisqu’ils n’agissent plus réellement faute de véritable projet politique et passent donc leur temps à rédiger des rapports ou à faire des consultations… Il s’agit d’un bon un exemple montrant qu’il est trop simplificateur de dire que la bureaucratie s’expliquerait par un nombre trop important de fonctionnaires. Sans mission claire ni volonté politique d’obtenir des résultats, 50 000 personnes aujourd’hui sont moins efficaces que 120 000 personnes hier. Je pense qu’en rejetant leur propre responsabilité sur le dos de l’administration, les politiques font, là encore, du populisme d’élites.
VdH : Il a été beaucoup questions ces deux dernières années du recours généralisé à des cabinets de conseil pour guider l’administration dans ce qu’on appelle parfois « la conduite du changement », ou bien pour rendre simplement des expertises techniques. Ce phénomène d’externalisation est-il nouveau ?
M. E. : Le rapport du Sénat qui a mis en évidence en 2022 ce phénomène a été établi, chose intéressante, par une élue communiste, Eliane Assassi, et un élu des Républicains, Arnaud Bazin. L’étude est donc transpartisane car elle touche au fonctionnement même de l’État. L’externalisation n’est pas une chose nouvelle, mais il faut distinguer deux formes d’externalisation. D’une part, l’externalisation des services publics correspond à ce qu’on peut appeler de la privatisation. D’autre part, dans sa forme la plus simple, l’externalisation consiste, pour l’État, à confier à des prestataires privés des fonctions qu’il exécutait auparavant en interne. Dans l’ensemble, aujourd’hui, l’externalisation coûte environ 170 milliards d’euros par an à l’État. Il y a parfois de bonnes raisons à cela, l’État n’étant pas voué à tout produire lui-même. Mais il y a souvent aussi de mauvaises raisons. Or l’externalisation mal encadrée, mal gérée, avec un suivi insuffisant de la part de celui qui veut externaliser peut rapidement s’avérer très coûteuse et dysfonctionner.

L’usage intensif des cabinets de conseil au sommet de l’État, ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan de l’externalisation d’un point de vue financier (1 milliard par an maximum). Mais ce qui choque en l’espèce, c’est que cela correspond à la privatisation de l’intérêt général, avec tous les problèmes qui en découlent. C’est ce qu’on appelle le design de politique publique. Les cabinets de conseil « dessinent », pour le pays, des orientations de politique publique. Par exemple, ce modèle a même inspiré la création du comité Cap 22, chargé en 2017 par Emmanuel Macron de décider de l’avenir de notre État et de nos services publics. Or ce comité était composé de 43 personnes, parmi lesquelles beaucoup de consultants, de banquiers d’affaires, de quelques hauts-fonctionnaires ayant généralement pantouflé… À sa tête avaient été nommés Véronique Bédague, PDG de Natixis et Ross McInnes, PDG de Safran, et aucun fonctionnaire, aucun élu local, aucun opérateur public. Il est peu étonnant ensuite que les décisions concernant les services publics aient l’air « déconnectées » et « hors sol » pour la majorité de la population.
Pour en revenir aux cabinets de conseil, le premier problème est que l’administration en devient le client. On peut davantage attendre d’un haut-fonctionnaire qui mène une étude qu’il soit neutre et indépendant, d’autant plus que son statut lui permet de pouvoir affirmer que telle décision du politique n’est pas une bonne décision ou qu’il y a du gaspillage d’argent public. Le cabinet de conseil, lui, est ultimement payé pour mettre dans son rapport ce que vous le client veut qu’il y mette. C’est une pratique très commune dans le secteur privé. McKinsey, BCG, Bain ont fait une bonne partie de leur fortune financière et réputationnelle en contribuant aux grands plans de licenciement et de restructuration aux Etats-Unis à partir des années 1980. Un grand groupe qui veut licencier 30 à 40 % de ses employés, plutôt que de l’annoncer directement, va plutôt demander à un cabinet de conseil de produire une analyse dont la conclusion sera le licenciement de 30 ou 40 % des salariés. Outil rhétorique, le rapport du cabinet permet de faire de la communication interne qui se donne les atours de la scientificité. Les cabinets de conseil ont proliféré aussi lors de la dissociation entre managers et actionnariat. En effet, ils permettent aux managers de se protéger par rapport aux actions : « D’accord, j’ai mené la boîte dans le mur, mais je n’ai fait que suivre le plan de McKinsey ! ».
Autre problème : les cabinets ne sont pas des spécialistes, mais seulement des généralistes de l’optimisation des coûts initialement. Ils vont donc appliquer des méthodes qui sont très différentes de ce dont l’État a besoin. On a certes besoin de regarder les coûts pour les services publics, mais on ne peut pas faire un plan de réforme pour la police, l’armée ou l’école sans prendre en compte les aspects de justice sociale, de sécurité, de souveraineté, d’accès aux services publics L’un des derniers points problématiques : ils ont accéléré le parachutage au sommet de l’État de personnes qui n’y connaissent rien et qui n’ont que le diplôme pour elles. Bien que venant des États-Unis, les cabinets de conseils ont su s’imposer en France parce que leur mode de fonctionnement coïncidait à l’illusion française de la supériorité du diplôme sur l’expérience et à la supériorité de l’intelligence généraliste sur l’expertise technique. Sortir de Polytechnique ou d’HEC permet de parler de tout, de traiter tous les sujets, d’utiliser Excel. Je relate des témoignes dans mon ouvrage de hauts-fonctionnaires de 50 ans qui avaient déjà vingt ou trente ans d’expérience, paradoxalement polytechniciens eux-aussi, et qui voyaient les jeunes générations d’HEC débarquer en costards-cravates pour leur expliquer ce qu’il fallait faire.
VdH : Vous écrivez que l’administration en est venue à perdre ses capacités d’expertise. Mais est-ce l’externalisation qui a conduit à cela ou est-ce un autre facteur causant la perte d’expertise, laquelle aurait conduit ensuite à externaliser ?
M. E. : Le lien de cause à effet est la perte d’attractivité. Je vais prendre un exemple à nouveau : à la fin d’une conférence que j’avais donnée, un haut-fonctionnaire du ministère des Armées, issu de Polytechnique, est venu m’aborder. Il m’a expliqué que ses camarades de promotion polytechniciens recrutés chez McKinsey prenaient des décisions pour le ministère des Armées quatre niveaux au-dessus de lui. Lui avait mieux réussi qu’eux dans les concours de sortie. J’ai entendu le même type de témoignages de la part des Polytechniciens du corps des ponts. Il faut au moins vingt ans d’expérience à un polytechnicien du corps des ponts pour atteindre la position qu’atteignent au même âge qu’eux leurs camarades de promotion partis en cabinet de conseil. La perte de compétences est ainsi liée au fait que l’État n’utilise plus ses compétences internes. Or une compétence non sollicitée finit par se perdre : soit parce qu’elle s’émousse, soit parce que les postes sont rendus inattractifs. Quand le ministère de l’Équipement bâtissait encore les infrastructures de la France, le travail était particulièrement stimulant. Aujourd’hui, les mêmes agents en sont réduits à faire des rapports sur l’externalisation, ils grattent du papier. C’est une tâche moins intéressante : donc les agents s’en vont. Par ailleurs, l’État – notamment en raison d’un complexe d’infériorité des fonctionnaires et des hauts-fonctionnaires par rapport au privé s’est mis à valoriser davantage les parcours à l’extérieur de lui-même plutôt que ceux qu’il promouvait en son sein. C’est l’un des pièges de la nouvelle ENA (ndlr : aujourd’hui l’INSP) : l’État impose des parcours qu’il ne valorise plus alors que la voie latérale par le privé procure davantage de chances d’arriver à son sommet. Cela n’a, rationnellement, plus aucun sens. Il serait bien plus logique, pour avoir de grandes responsabilités au sein de l’État d’évoluer dans l’État lui-même.
« Bien que venant des États-Unis, les cabinets de conseils ont su s’imposer en France parce que leur mode de fonctionnement coïncidait à l’illusion française de la supériorité du diplôme sur l’expérience et à la supériorité de l’intelligence généraliste sur l’expertise technique »
S’agissant de la perte des expertises qu’on n’utilise plus, je vais prendre l’exemple du nucléaire. Vous construisez vingt centrales nucléaires en dix ans : vous avez un savoir-faire. Puis vous interrompez le programme nucléaire pendant vingt ans ; ensuite, plus personne ne sait faire. Les formations sont fermées car elles ne débouchent plus. Aucun jeune ne va raisonnablement s’engager là-dedans pour vingt ans, si tous les trois ans on assiste à un changement de politique. Sans compter le temps pour que les universités et grandes écoles recréent les formations adéquates.
VdH : Au cours des années 1980, les conseillers qui gravitaient à la Maison Blanche autour de Ronald Reagan ont théorisé une stratégie visant à faciliter la cession au marché concurrentiel de pans entiers du secteur public. Pouvez-vous nous en décrire le mécanisme ?
M. E. : C’est ce qu’on a appelé avec cynisme la stratégie starve the beast (« affamer la bête »). Voici le contexte. Ronald Reagan a initié au début des années 1980 avec Margaret Thatcher la contre-révolution conservatrice, ce mouvement selon lequel l’État est l’adversaire. Reagan affirmait que « l’État n’était pas la solution au problème mais le problème » et, reprenant une phrase de Thomas Jefferson, que « le gouvernement qui gouverne le mieux est celui qui gouverne le moins ». Or comment supprimer des services publics alors même que la population s’y est attachée ? Il fallait donc remettre sur les services publics la responsabilité de leur propre suppression. La méthode qui a été alors théorisée – starve the beast – consiste pour commencer à couper les fonds octroyés à ces services. Manquant de moyens, ils vont moins bien fonctionner. Comme ils vont moins bien fonctionner, ils vont susciter de plus en plus de mécontentement.
Je peux l’illustrer par l’exemple concret d’un témoignage que j’ai recueilli: les infirmières d’un service hospitalier qui étaient auparavant dix pour cent patients par nuit ne sont plus que cinq pour deux cents patients par nuit à la suite de la fermeture d’autres services d’urgences et des suppressions de postes. Les patients sont donc moins bien soignés. Les tensions en interne augmentent parce que c’est beaucoup plus difficile, les soins prodigués sont de moins bonne qualité… Dans ce contexte, il est facile pour un dirigeant politique de dire : « Vous voyez, le public fonctionne mal. Le privé ferait certainement mieux ! ». Consciemment ou inconsciemment, l’alibi est tout trouvé pour continuer à couper les fonds avec un cercle vicieux : l’accroissement des dysfonctionnements, la perte de sens au travail avec exigences accrues de rentabilité (cf. la transformation de la Poste). Au bout de la démarche, vient la privatisation. Forcément, après avoir saboté le secteur public, on peut établir le constat que le secteur privé fonctionne mieux… De même, on entend dire que les entreprises publiques fonctionnent moins bien que celles qui ont été privatisées. Or, c’est par pur effet de construction, puisqu’on a privatisé toutes les entreprises publiques bien gérées, tandis que l’État a conservé celles qui étaient mal gérées. La Chine a fait l’inverse : elle a privatisé les entreprises publiques qui fonctionnaient moyennement, mais gardées publiques les entreprises performantes pour pouvoir tenir le discours inverse : le public fait mieux que le privé. Tout dépend donc de la manière dont est composé le portefeuille d’entreprises publiques.
VdH : Est-ce cette même stratégie qui a été mise en œuvre pour démanteler progressivement EDF ?
M. E. : Non, le cas d’EDF est différent. La machine EDF fonctionne encore. Il y a le service public de l’électricité, bien sûr. Cependant, EDF en tant que telle n’est pas un service public, mais une entreprise rentable qui possède sa propre autonomie, à part entière. L’entreprise EDF a été surtout bridée progressivement par un ensemble de régulations mais aussi par des mauvais choix stratégiques, dont des changements d’avis continus, qu’on appelle les stop and go. Sur le nucléaire, par exemple, Emmanuel Macron avait exprimé en 2018 sa volonté de fermer une quinzaine de centrales. En 2021, il a changé d’avis en décrétant qu’il fallait en construire douze. Or, cela ne se planifie pas sur deux ans, mais sur trente ans ! Comme toutes les entreprises publiques qui fonctionnent bien, EDF suscite la convoitise des intérêts privés car elle est assise sur une manne énorme. C’est l’une des dernières qui n’a pas été privatisée.
« On entend dire que les entreprises publiques fonctionnent moins bien que celles qui ont été privatisées. Or, c’est par pur effet de construction, puisqu’on a privatisé toutes les entreprises publiques bien gérées, tandis que l’État a conservé celles qui étaient mal gérées »
En 2020, Emmanuel Macron avait imaginé le projet « Hercule » qui consistait à diviser EDF en trois. Diviser permet de collectiviser les pertes et de privatiser les profits. Si une entreprise publique investit énormément, avec une partie de coûts et une partie rentable, la logique pour les intérêts privés est que l’État garde la partie coûts et investissements et cède la partie profits à des acteurs privés qui n’ont fait aucun investissement. C’est déjà un peu le cas, puisqu’une sorte de faux marché de distribution de l’électricité a été créé en France. Je dis « faux » car EDF reste le seul producteur d’électricité mais il est contraint de revendre l’électricité produite à ses concurrents qui, eux ne l’ont donc pas produite, et qui la revendent plus chère aux consommateurs en s’octroyant donc un profit…
VdH : À entendre nos « décideurs », on a l’impression que beaucoup d’indicateurs de l’action publique sont au beau fixe, comme si les réformes portaient finalement leurs fruits. Pourtant, le besoin effréné de réformer encore et toujours tend à démontrer par l’absurde que toutes ces réorganisations de l’État sont un échec. Le nouveau management public a-t-il quand même des vertus ?
M. E. : Il y a certes quelques formes aiguës de déni qui peuvent encore subsister, mais je n’ai plus l’impression que l’heure soit à parler d’indicateurs au vert. Il n’y a qu’à constater les discours alarmistes sur les déficits publics. La célèbre phrase de Bossuet est plus que jamais à l’ordre du jour : « Dieu se rit des hommes qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes.» Nos responsables politiques constatent aujourd’hui le dysfonctionnement de l’école publique, des hôpitaux, des comptes publics. Mais comme ils persistent dans la logique starve the beast, ils continuent d’accuser l’administration d’un sabotage qu’ils orchestrent eux-mêmes. Ils se sont mis en tête que tout dysfonctionnement de l’État est lié à trop d’État. La solution ne peut donc que résider dans la fragilisation de cet État alors même que, très souvent, le problème est l’absence de l’État dans certains secteurs. C’est toute la logique néolibérale.
Je me permets une digression sur les plans d’ajustement structurels que j’ai pu étudier. Il y avait ce cas absurde à Madagascar où le FMI est intervenu dans les années 1980 en estimant que si l’État dysfonctionnait, c’est donc qu’il y avait trop d’État. Or, le problème était précisément inverse : il n’y avait alors que deux fonctionnaires pour cent habitants (contre vingt-quatre en France à la même époque). Madagascar, sur la recommandation du FMI, a donc… supprimé des postes de fonctionnaires. Il n’y a plus désormais que 0,75 fonctionnaire pour 100 habitants et des pans entiers du territoire ne sont même plus administrés. À ce rythme, pour régler le problème, l’État pourrait aussi fermer boutique et l’on peut revenir à l’époque des clans et des tribus. On ne cherche même pas à analyser ce qui ne marche pas.
Maintenant, est-ce que le new public management a du bon ? Oui, dans les intuitions initiales, il y a toujours du bon. Si quelqu’un arrive et vous dit : « Je veux rendre l’État plus efficace », c’est une chose positive. Qui répondrait non ? Mais la vraie question reste la manière dont on s’y prend. Par ailleurs, le new public management est difficile à définir. Initialement, cette idéologie consiste à dire que l’État doit être géré comme une entreprise, mais c’est en réalité un peu plus complexe que ça. Il a produit des choses assez étranges, en particulier de la bureaucratie. Par exemple, il a conduit à considérer que, si une administration est trop lourde, mieux vaut créer une task-force, qui prendra la forme d’une agence à côté du ministère. Résultat : on a conservé les ministères tout en créant des agences. Il arrive parfois qu’une quinzaine d’institutions gèrent la même chose avec une dilution complète de responsabilité. Pendant la crise du covid, il existait déjà une douzaine d’agences de santé, mais Emmanuel Macron a décidé de créer en plus plusieurs comités sanitaires. Cela n’a conduit à rien. Idem dans le domaine sportif, avec la création en 2018 de l’Agence nationale du sport… à côté du ministère des Sports. L’un et l’autre se renvoient la compétence à chaque problématique posée… C’est tout le paradoxe du bureaucratisme néolibéral : le new public management a lui-même créé une nouvelle forme de bureaucratie, notamment en multipliant les strates de contrôle et de reporting de l’activité des agents, qui a fait gonfler une administration intermédiaire, laquelle s’est substituée à celle qui existait déjà. Sans expertise sérieuse sur la façon de mettre ce système en place, il a produit l’effet inverse.
VdH : Comment la communication et l’usage d’une forme de novlangue édulcorent-ils auprès de l’opinion ce qui n’est finalement que la liquidation de l’État ?
M. E. : Il y a beaucoup d’hypocrisie dans les termes choisis. Ce sont systématiquement des termes difficiles à critiquer, qui affichent toujours une bonne intention. C’est mon exemple cité précédemment : « Rendre l’État plus efficace ». Autre exemple : le raisonnement selon lequel « il faut supprimer des postes de fonctionnaires afin de réduire la dépense publique et donc diminuer les impôts ». Tout le monde est d’accord avec la réduction des dépenses publiques. Pas de chance : jamais la diminution d’une dépense publique ces vingt dernières années n’a mené à une basse d’impôts ! L’État comprend aujourd’hui tellement de postes de dépenses et un tel déficit, que s’il diminue les dépenses dans tel ou tel secteur, il les réallouent ailleurs. J’avais étudié un cas concret de réduction des dépenses à Bercy grâce à un chantier de numérisation (10 000 postes de fonctionnaires supprimés). Où sont allées ces économies ? Dans l’augmentation de la rémunération et les bonus des hauts-fonctionnaires du ministère !

La novlangue est extrêmement dangereuse dans le sens où elle rend une affirmation difficilement attaquable. Je cite dans mon livre de nombreux exemples issus de la terminologie des cabinets de conseil : « optimisation » et « rationalisations » au lieu de coupes budgétaires, « redimensionnement capacitaire » au lieu de suppressions de lits d’hôpitaux, « conventionnement sélectif » pour la réduction du remboursement de la Sécurité sociale. On parle aussi de « lean management » pour supprimer les postes. L’utilisation de vocables anglais donne un aspect de technicité, de scientificité. L’une des raisons pour lesquelles j’ai voulu écrire mon livre dans un style simple, c’est car je pense qu’il est très important pour le débat et la vie démocratiques de décrire les choses telles qu’elles sont et non telles qu’elles sont racontées par nos dirigeants. Les Français pensent adhérer aux intentions affichées, mais les résultats ne sont pas conformes aux promesses. Or, si personne ne fait le bilan, on ne s’attaquera jamais aux bonnes causes des problèmes.
VdH : Vous avez évoqué, au début de cet entretien, la transformation affichée de l’État sur le modèle de la start-up. Or, en 2016, alors que se précisait une candidature d’Emmanuel Macron à l’Élysée, celui-ci a signé la préface d’un étonnant ouvrage, L’État en mode start-up, co-écrit par deux de ses proches : Thomas Cazenave (aujourd’hui député Renaissance) et Yann Algan (économiste). Ce livre est passé sous les radars alors qu’il contient des idées aussi détonantes qu’inquiétantes sur la projection macronienne des services publics… Que proposaient les auteurs ?
M.E. : Emmanuel Macron a peu écrit sur l’État, mais dans ce cas-là, il a effectivement préfacé ce livre – peut-être l’a-t-il même globalement co-rédigé dans la mesure où Thomas Cazenave était son directeur de cabinet adjoint – et la vision est en effet intéressante. Il y a quelques idées-clef qui se dégagent du livre. La première est celle d’une administration 100 % numérique. Il pense que, grâce au digital et au numérique, nous allons enfin pouvoir parvenir à l’idéal d’un État sans fonctionnaire. Tout serait numérisé, tout serait plateformisé. C’était à l’époque le début de l’ubérisation, des marketplaces, etc. La deuxième idée est celle de co-production des services publics. Les auteurs expliquent que ce n’est plus à l’État d’offrir des services publics (en contrepartie des impôts et des cotisations, je le rappelle !) mais qu’il faut que les usagers les produisent eux-mêmes. Il cite certains exemples totalement absurdes. D’autres sont un peu plus simples : l’hospitalisation à domicile notamment, avec des infirmières privées de passage. Il s’agirait bien d’un État-plateforme, « agile », avec uniquement des formalités administratives numérisées et tout le reste serait assuré par le privé ou par les citoyens entre eux. C’est une vision très étriquée, très réductrice, du rôle d’un État, interrogeant même sur la connaissance que ceux qui ont écrit ce livre ont réellement de l’État et de son périmètre d’action. Il faut reconnaître à Emmanuel Macron d’avoir, par la numérisation, facilité les formalités administratives par Internet. Très bien. Mais les formalités représentent environ 5 % seulement des activités de l’État. Quand on sait ce que signifient vraiment l’État et les services publics, c’est un effort infime et qui a surtout servi d’alibi pour continuer à supprimer des services de proximité dans les territoires alors qu’ils y jouaient un rôle essentiel. Ils sont aujourd’hui remplacés par des maisons génériques des services publics, un guichet unique. J’ai bien peur qu’il en soit de même avec l’arrivée de IA, prétexte pour supprimer des postes alors même qu’elle n’apporte pas ce que peut apporter un enseignant, un infirmier, un policier.
VdH : Alors que nous sommes en pleine élaboration du budget 2025 et que l’état catastrophique des finances publiques conduit le gouvernement à réfléchir à des coupes dans les dépenses publiques, quels seraient selon vous les postes de dépenses sur lesquels il y aurait des économies justifiées à faire ?
M. E. : Il n’existe pas suffisamment d’études faites sur les véritables coupes à faire. Mais je pense qu’il y a énormément de gaspillage d’argent. On paye toujours plus cher et les services sont de moins en moins bonne qualité : cela veut bien dire qu’il y a des fuites dans tous les sens. Mais nous n’avons pas forcément de bonnes analyses des grandes masses, de là où part cet argent, notamment parce que la comptabilité des services décentralisés est assez opaque. L’un des pièges serait de vouloir couper dans les grandes masses alors que, très souvent, ce qu’il y aurait à faire est plus fin.
« Le déficit public français vient aussi d’une amputation des partie des recettes. Si l’impôt sur les sociétés n’est pas suffisant, cela peut aussi dire qu’il n’y a pas assez de sociétés dans le pays pour cotiser »
Je pense aussi que des économies viendront d’un meilleur fonctionnement de services plutôt que de supprimer des postes. À coût équivalent, que demande-t-on aux fonctionnaires sur le terrain ? Quand j’interroge les médecins de l’hôpital public, ils me répondent que remplir tous les tableaux de reporting imposés leur prendrait quatre heures par jour. De même, les policiers passent un temps de plus en plus court en patrouille car ils remplissent tellement de paperasse qu’ils peuvent moins être sur le terrain. Deuxième question : à quoi sert toute l’administration intermédiaire que le new public management a créée, car on a fait gonfler les strates d’évaluation, de contrôle des fonctionnaires, sans qu’il y en ait nécessairement besoin. Des services fonctionnaient très bien (école, hôpital…) avant que tout ce contrôle et ces normes n’apparaissent. Troisièmement, on évoque beaucoup les dépenses de l’État lui-même en termes de dépenses de personnels…. Mais on ne parle pas des autres postes de dépenses, notamment des subventions diverses, qui échappent souvent au débat sur l’économie publique. Or, il y a des manques à gagner absolument colossaux. Pour la construction d’éoliennes par exemple, l’État a déversé à peu près 20 milliards d’euros de subventions, une somme qui est immédiatement sortie du circuit national. Les Français ne sachant pas produire des éoliennes, les sommes en question sont parties en Chine, en Allemagne ou aux États-Unis… Autre exemple : le manque à gagner de la concession des autoroutes publiques est d’environ 10 milliards d’euros annuels. On peut toujours s’en prendre aux enseignants et réussir à économiser 100 millions d’euros en supprimant des postes. Mais quand, parallèlement, sont dilapidés 10, 20, 50 milliards d’euros en pure perte, un sérieux problème se pose… Aujourd’hui, on raisonne en termes de suppression de services, mais cela n’a aucun sens. L’ex-ministre de la Fonction publique Guillaume Kasbarian avait dit : « Le Président de la République m’a donné comme objectif de supprimer 10 % des agences. » Pourquoi 10 % ? On ne sait pas puisqu’on ne s’est pas demandé si elles étaient utiles, si elles remplissaient leur rôle initial, etc. Il n’y a aucune analyse sérieuse là encore.
Enfin, on parle trop peu souvent du volet recettes. Or, le déficit public français vient aussi d’une amputation des partie des recettes. Si l’impôt sur les sociétés n’est pas suffisant, cela peut aussi dire qu’il n’y a pas assez de sociétés dans le pays pour cotiser. Nous sommes donc dans un moment de choix collectif : soit on s’appauvrit collectivement en considérant qu’en ayant plus assez de recettes, on supprime les services publics et on risque de devenir progressivement un pays en développement ; soit on essaie d’identifier là où on perd vraiment de l’agent, on occupe les agents publics à faire ce qu’on voudrait qu’ils fassent et on relance de l’activité économique et notre industrie. Ainsi pourra-t-on continuer à financer nos services publics plutôt que de les démanteler.
VdH : Après un premier essai consacré aux politiques mémorielles (La Mémoire coupable, 2022) puis votre ouvrage La Destruction de l’État, sur quoi porteront vos prochaines recherches ?
M. E. : Il m’apparaît essentiel de poursuivre l’analyse débutée sur l’État. Je travaille donc sur un projet d’essai qui porterait davantage sur des aspects économiques (décrochage, échec de la relance industrielle, perte du contrôle des entreprises et fuite des capitaux…). Il y a beaucoup à faire en la matière. À mon sens, l’État au sens large possède trois versants : l’administration elle-même (fonctionnement de l’État), l’économie et la finance (auxquelles sont liés la dette et le déficit) et les relations internationales. Pour l’instant, je concentre mes recherches sur les deux premiers volets de cette « trilogie », convaincu que la place de la France à l’international en découle. Je suis convaincu qu’en posant mieux les problèmes, on est plus à même de trouver des solutions. Je suis, par ailleurs, en train de travailler sur un projet d’ouvrage collectif comportant des propositions de solutions. Si ce livre m’a bien permis quelque chose, c’est de rencontrer tout un ensemble de personnes qui portent ces discours-là, au moins dans leur secteur mais parfois aussi avec un point de vue systématique. Le problème est que chacun se trouve assez isolé. On n’a pas encore atteint la masse critique pour faire entendre un autre discours avec les bons mécanismes argumentatifs car, dans le combat médiatique, la force de frappe qui se trouve en face est beaucoup plus puissante ! D’autant plus puissante que les médias sont entre les mains de huit ou neuf milliardaires qui ont des intérêts et qui défendent, idéologiquement, l’agenda libéral et mondialiste. Or eux ou les élites auxquelles ils s’adressent n’utilisent pas les services publics… du moins le pensent-ils ! Car on commence à entendre les élites économiques se plaindre du manque d’enseignants dans les lycées privés ou de médecins spécialistes à l’Hôpital américain, tout se demandant bien pourquoi… J’espère que cela provoquera un début de prise de conscience de leur part. L’eau monte tellement qu’elle commence à toucher la cabine du capitaine. »
Entretien réalisé à Paris le 29 novembre 2024.






Laisser un commentaire