
David Cayla est enseignant-chercheur en économie à l’Université d’Angers et membre du conseil d’administration des Économistes atterrés. Il est notamment l’auteur de L’Économie du réel face aux modèles trompeurs mais aussi de La fin de l’Union européenne et 10+1 questions sur l’Union européenne (tous deux co-écrits avec Coralie Delaume).
Propos recueillis par Ella Micheletti.
Voix de l’Hexagone : L’économie redémarre à la suite de la crise du covid-19. À quel modèle de reprise peut-on s’attendre en Europe et ailleurs dans le monde ?
David Cayla : Je pense qu’il va y avoir une reprise, d’ailleurs elle est déjà là. Mais elle ne va sans doute pas permettre de rétablir le niveau d’activité existant avant la crise. Pourquoi ? Parce que la crise a eu un impact sur le pouvoir d’achat, sur la santé et la trésorerie de beaucoup d’entreprises. On assiste en ce moment à de nombreux licenciements, à la non-reprise d’intérimaires et à des fins de CDD. Le taux de chômage a déjà augmenté et va sans doute continuer d’augmenter malgré les mesures gouvernementales. On va se retrouver, en définitive, à un niveau d’activité qui sera forcément plus faible parce que les revenus des ménages vont être réduits. L’INSEE prévoit une récession en 2020 mais il faut s’attendre à ce que le dernier trimestre de l’année en cours ne soit pas au niveau du dernier trimestre 2019, même sans reprise épidémique. La récession va donc se prolonger, sans mesures de relance, jusqu’à la fin de l’année.
VdH : La rigueur budgétaire a été pointée du doigt pendant la pandémie comme un facteur aggravant (désorganisation du système hospitalier, manque de matériel, liquidation des stocks de masque). Pour vous, la crise sanitaire sonne-t-elle le glas de cette politique ou faut-il craindre au contraire que la récession, dont nous venons de parler, en accélère le cours ?
D.C. : Il faut bien voir deux choses. Il y a d’un côté le manque de moyens dans les hôpitaux, d’un autre côté le manque de masques. Ce n’est pas à cause de l’austérité qu’il n’y a pas eu de masques. Le problème a été le manque de préparation du gouvernement face à la crise. Le premier conseil de défense consacré à la crise du covid a servi à décider de l’utilisation de l’article 49.3 pour adopter la réforme des retraites ! Nous sommes fin février et, à ce moment-là, le gouvernement n’a pas pris conscience de la crise qui venait. Cette impréparation n’est pas liée à la politique d’austérité mais à une incompétence du gouvernement entre janvier et début mars. C’est la première chose.
La seconde est effectivement la désorganisation des hôpitaux. Même sans politique d’austérité, la crise aurait été extrêmement difficile à gérer parce qu’aucun système hospitalier ne peut prévoir un nombre de lits qui surpasse complètement les situations rencontrées d’habitude. Cette crise était très particulière car les nombreuses personnes placées en réanimation y restaient au moins deux semaines. Le taux d’occupation des lits était en conséquence très important. Ce n’est pas en soi l’austérité qui explique la saturation des hôpitaux. Par contre, l’organisation du système de santé en France est marquée par de très nombreuses réformes fondées sur le principe d’un contrôle des dépenses et de l’activité des soignants. Ce « nouveau management public » vise à aller vers l’efficacité par le sur-contrôle qui entraîne lui-même une bureaucratisation. Le vrai désarroi des soignants se trouve dans la question des salaires, certes, mais aussi dans cette nouvelle forme de management qui instaure une méfiance généralisée à l’égard des soignants. Les agences régionales de santé (ARS) pilotent un ensemble d’hôpitaux avec à l’esprit non pas l’idée de prodiguer des soins mais de rendre ces soins les moins coûteux par rapport au volume de prestations. Les ARS ne jouent pas le rôle qui serait attendu d’elles : celui de préserver la santé des gens et d’organiser correctement les hôpitaux. La logique de réduction des coûts imprègne toute la hiérarchie administrative. Cela entraîne l’incapacité pour les soignants de vraiment faire leur métier. C’est bien cela qui ressort de leurs témoignages. En disant que le problème de l’hôpital public est l’austérité, on oublie les deux autres : le management et l’impréparation du gouvernement dans le cas spécifique du covid-19.
« La logique de réduction des coûts imprègne toute la hiérarchie administrative. Cela entraîne l’incapacité pour les soignants de vraiment faire leur métier »
Peut-on changer tout ça ? Cela relève de la décision politique. Emmanuel Macron a beau dire qu’il est en train de « se réinventer », j’ai dû mal à voir comment. Bien sûr, il est difficile aujourd’hui de deviner ce qui va sortir du « Ségur de la Santé ». Mais ce qu’on constate déjà, c’est que ce n’est pas un moment de véritable concertation. Ce n’est surtout pas un moment de négociation car cela fait désormais très longtemps – depuis Sarkozy – qu’on a abandonné l’idée même de négocier avec des interlocuteurs. Ce que l’on appelle aujourd’hui « concertation » est une forme de cirque médiatique dans lequel on fait venir les gens pendant deux heures pour les faire parler, puis les décisions se prennent ensuite. C’est le même processus suivi dans l’éducation, en pire, et dans tous les secteurs publics. Le néo-management ne vise pas à faire sortir des solutions d’un rapport de force mais cherche à imposer des directives sans vrai dialogue avec la base.
VdH : Dans son allocution du 14 juin dernier, le président Macron a évoqué un « pacte productif » pour la France. S’oriente-t-on finalement vers une stratégie de relance nationale, alors que les mesures annoncées jusqu’à présent étaient plutôt des aides aux secteurs sinistrés ?
D.C. : Le « pacte productif » donne l’impression que Macron veut relancer la production. Il parle aussi de « souveraineté » économique à rétablir en France. Mais concrètement, cela se traduit par des négociations avec des chefs d’entreprise pour leur demander de suspendre des délocalisations ou d’investir en France. Ce n’est pas un plan de relance, c’est une forme de « discussions entre copains ». Par exemple : on vient d’apprendre que la production de paracétamol serait relocalisée en France, et plus en Asie. Mais on voit bien les limites de cela : par exemple, on a demandé à des entreprises françaises de produire des masques en tissu avant finalement d’aller en commander à l’étranger car le coût de la main d’œuvre y est moins élevé. Il y a donc une forme de contradiction entre les discours et les actes.
Un vrai plan de relance consisterait, de mon point de vue, à prévoir des investissements publics. Or, pour l’instant, rien n’a été dit. Il serait aussi envisageable pour l’État d’élaborer un plan d’emploi public. Par exemple, il manque des fonctionnaires dans la santé, dans l’éducation, dans la sécurité. Cela permettrait de résoudre en partie la question du chômage. Mais ce n’est pas du tout à l’ordre du jour. L’exécutif commence à dire qu’il faudra travailler plus, mais sans vouloir embaucher plus… Comment faire si les entreprises licencient et que l’État n’embauche pas ?
En revanche, l’idée d’un plan de relance européenne est très présente chez Macron, avec un investissement de 500 milliards d’euros. Ce n’est qu’un projet à ce stade. Le projet émane du couple franco-allemand. Il est soutenu par la Commission européenne mais n’a pas encore été accepté par les États-membres. Il sera sans doute amendé s’il est accepté. Il prévoit des dépenses qui seront, premièrement, conditionnelles (l’argent sera distribué pour des projets précis) ; deuxièmement, limitées parce que 500 milliards pour six ou sept ans, cela fait peu d’argent à répartir. Ce qu’on ignore encore – dans l’attente des négociations – c’est si ce plan va être adossé à des emprunts ou à une ressource propre, c’est-à-dire, par exemple, une taxe carbone ou autre qui pourrait être déterminée pour le financer. Dans l’hypothèse où les emprunts des États le financent, un mécanisme de solidarité (partage de la dette publique) pourrait être mis en place mais pour un montant limité. Si c’est une taxe particulière collectée à l’échelle des États mais redistribuée à l’échelle européenne, ce serait une victoire pour les partisans d’une Europe fédérale et un pas important aurait été franchi dans l’intégration européenne. Mais tout cela est à mettre au conditionnel. Il faut donc attendre.
VdH : Certains observateurs se disent pessimistes pour l’avenir de la zone euro. Pensez-vous que la monnaie unique puisse être la dernière victime du coronavirus ?
D.C. : J’irais plus loin encore. Dans mes travaux, je démontre que le problème de l’Union européenne est moins la monnaie unique que le marché unique, avec ses effets de polarisation, d’agglomération industrielle. Cela signifie que l’ensemble du territoire européen est très hétérogène, notamment en termes d’activité industrielle. La libre circulation du travail et du capital aboutit à des pôles industriels qui attirent les investissements de tous les pays. Certains pays se vident de leurs ressources industrielles et donc de leur capacité à exporter, indépendamment du fait qu’ils appartiennent ou non à la zone euro. Dit autrement, les régions riches s’enrichissent, les régions pauvres s’appauvrissent. Les populations les plus éduquées, les plus jeunes et vives, ont tendance à se déplacer facilement et privent les pays d’origine de leur capital humain. Un pays comme la Bulgarie, par exemple, forme de nombreux jeunes qui émigrent ensuite en Allemagne, en France ou au Royaume-Uni. Le même phénomène est en train de se produire en Italie. Les inégalités intrinsèques entre zones économiques s’en trouvent renforcées.
« Les régions riches s’enrichissent, les régions pauvres s’appauvrissent. Les populations les plus éduquées, les plus jeunes et vives, ont tendance à se déplacer facilement et privent les pays d’origine de leur capital humain »
La question finit donc par se poser de la survie d’un tel mécanisme. Des États dépourvus de base industrielle vont devoir emprunter pour financer leur économie auprès d’autres États puisque, dans une zone monétaire unique, l’épargne circule librement. Mais ce système-là ne fonctionne plus. Les Allemands, premiers épargnants d’Europe, sont aujourd’hui réticents à prêter aux Italiens ou aux Espagnols. La zone euro était censée être harmonieuse, mais elle ne fait plus circuler l’épargne et les systèmes financiers se recloisonnent. Paradoxalement, cela ne veut pas dire que l’euro va éclater même s’il ne sert plus à rien, sinon à produire des effets négatifs pour les pays d’Europe du Sud.
VdH : Dans cette situation post-covid, comment les États européens peuvent-ils recouvrer leur souveraineté sanitaire et industrielle ?
D.C. : La première chose à faire quand on veut rétablir une forme de souveraineté économique est, d’abord, de mener une politique industrielle. Cela implique une réflexion stratégique : quelles activités veut-on établir sur le sol national ? Les masques, les médicaments bien sûr, au regard du contexte, mais, dans une économie, on doit pouvoir accéder à d’autres ressources. Je suis personnellement très inquiet s’agissant des ressources alimentaires de la France, dont la puissance agricole décline depuis une vingtaine d’années, notamment depuis la réforme de la PAC. Or, nourrir sa population est bien un enjeu stratégique pour l’État.
Ensuite, une fois qu’il est déterminé à mener une politique industrielle, l’État se retrouve confronté à des contraintes extérieures. Les traités européens en font partie, en interdisant aux États d’intervenir dans l’économie au nom de la concurrence libre et non faussée. Il y a quelques moyens de contourner cet obstacle, notamment en protégeant certains secteurs mais cela reste difficile. On ne peut pas vraiment reconstruire des filières dans le cadre des traités actuels. Par ailleurs, d’autres traités commerciaux, négociés directement par l’Union européenne, compliquent encore les choses. Cela aurait un intérêt de passer commande auprès de producteurs français de masques, par exemple, même si des masques à moindre coût peuvent être fabriqués au Vietnam. Cela permettrait d’encourager l’emploi local. La théorie économique révèle là un trou dans sa pensée : l’efficacité et le prix ne sont pas la même chose. Le salaire est une redistribution de richesse, pas une marque d’inefficacité productive. Si l’ouvrier vietnamien est payé dix fois moins que l’ouvrier français, ça ne veut évidemment pas dire qu’il est dix fois plus efficace. L’enjeu de la mondialisation et du libre-échange n’est pas un enjeu d’efficacité, contrairement à ce que disent nombre d’économistes, mais un enjeu de répartition des richesses. Donc, contourner les traités européens et revoir les autres traités commerciaux est le deuxième élément indispensable pour rétablir la souveraineté économique. C’est aujourd’hui un vœu pieu pour qui se dit pro-européen.
VdH : Dans votre ouvrage L’économie du réel (De Boeck, 2018), vous vous êtes 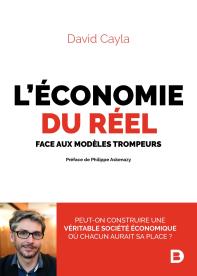 attaché à démontrer par des exemples très concrets que les lois du marché ne permettaient pas de répondre pertinemment aux besoins des hommes en période ordinaire. N’est-ce pas plus vrai encore en période de crise (pénuries, offre de soin inadaptée…) ?
attaché à démontrer par des exemples très concrets que les lois du marché ne permettaient pas de répondre pertinemment aux besoins des hommes en période ordinaire. N’est-ce pas plus vrai encore en période de crise (pénuries, offre de soin inadaptée…) ?
D.C. : Je ne me pose pas la question d’un point de vue conjoncturel. Ce qui m’intéresse dans cet ouvrage-là et plus globalement dans ma réflexion actuelle est de faire ressortir qu’il n’y a pas de démonstration convaincante du fait que les marchés sont par nature efficaces, que l’on soit en période de crise ou non. Cela ne veut pas dire que les marchés n’ont pas une forme d’utilité. Je ne suis d’ailleurs par opposé au marché dans la vie économique. Mais je remets en cause l’idée qu’ils sont le seul système efficace car elle conduit à mettre en place des politiques qui ignoreront les domaines dans lesquels le marché n’est pas efficace. En période de crise profonde où la solution passe par l’État (prise en charge des revenus privés pour éviter l’effondrement économique), on ne pourrait pas compter sur le marché pour obtenir de tels résultats. Quelle en est la raison ? C’est qu’une idéologie qui consiste à dire que les marchés sont la solution se trouve mise en défaut lorsqu’il devient nécessaire, de fait, que l’État intervienne.
VdH : Vous travaillez actuellement sur un nouvel essai relatif à l’articulation entre populisme et néolibéralisme. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
D.C. : Depuis un certain nombre d’années, nous sommes confrontés à des révoltes électorales qui ont entraîné le Brexit, l’élection de Donald Trump, le retour d’une droite dure qui fracture l’Europe orientale (le groupe de Visegrad). Les mouvements populistes dans ces pays sont puissants et dirigent le pays. Ceci change la façon de faire de la politique et inquiète beaucoup, notamment parmi les intellectuels. À mon avis, à juste titre. Par exemple, je ne pense pas qu’on puisse dire que Trump ou Bolsonaro aient très bien géré la crise sanitaire. Je ne pense pas que l’anti-élitisme suffise à faire une politique mais cela constitue au contraire une régression du débat politique, aujourd’hui en état de déliquescence. Ce qui s’est passé autour de l’hydroxychloroquine est révélateur : bien des gens se sont mis à avoir un avis sur le sujet, non pas fondé sur les productions scientifiques mais sur une forme d’anti-élitisme incarné par les cheveux longs de Didier Raoult… Une réaction d’autant plus aberrante que cet homme est lui-même au cœur de l’élite du système de santé depuis longtemps. Mais par sa manière d’être ou de parler, des gens se sont identifiés à lui dans un contexte où Macron lui-même était discrédité pour de bonnes raisons.
« Des gens se sont mis à avoir un avis sur l’hydroxychloroquine fondé sur une forme d’anti-élitisme incarné par les cheveux longs de D. Raoult. Une réaction aberrante car cet homme est au cœur de l’élite du système de santé depuis longtemps »
Des intellectuels se sont mis à écrire sur le populisme pour essayer de le décrire et de l’identifier. De mon point de vue, la manière dont ils le font néglige un aspect important : l’aspect économique. Ce qui m’intéresse, c’est la manière dont le néolibéralisme – c’est-à-dire une manière particulière de gérer l’économie de marché – a dépossédé les États de leur pouvoir d’intervention. Si on veut comprendre en deux mots ce qu’est le néolibéralisme, disons que l’État doit organiser le cadre du marché mais ne doit surtout pas intervenir. Cela entraîne une frustration démocratique extrêmement forte, qui s’incarne dans le populisme. C’est cela que je souhaite montrer dans mon prochain livre, en soulignant que les économistes eux-mêmes ont du mal à comprendre cela. Thomas Piketty, par exemple, ne questionne jamais le marché. Les solutions proposées sont taxer davantage et redistribuer davantage… mais surtout pas remettre en cause la mondialisation et le fonctionnement du marché ! Cela conduit à une impasse, en l’occurrence à penser que le populisme est un mouvement qui revendique juste davantage d’allocations. C’est se tromper sur la nature de ce mouvement qui est une revendication de démocratie même s’il ne s’incarne pas dans des personnalités recommandables. Mais lui répondre par la seule redistribution des richesses est une solution difficile dans le cadre de la mondialisation actuelle avec la concurrence entre tous les pays qu’elle instaure. La question fondamentale est celle du pouvoir de l’État dans l’économie. Je souhaite mettre en exergue cette impasse de la pensée économique sur l’organisation néolibérale du monde pour traiter du populisme.
VdH : Vous avez parlé de « personnalités peu recommandables » portées par un populisme plutôt droitier mais un « populisme de gauche », tel que défini par Chantal Mouffe, ne pourrait-il pas justement produire des incarnations plus positives ?
D.C. : Je ne vois pas vraiment de populisme de gauche, pour tout vous dire. Il apparaît aujourd’hui que le discours anti-élite qui est au cœur du populisme, du « nous contre eux », me paraît très flou et pas porteur d’une théorie structurée, en particulier sur des questions de souveraineté, sur la question européenne, sur celle du libre-échange ou de la mondialisation. Il n’y a pas de substance parce que le populisme, de gauche ou de droite, est toujours un mouvement de réaction, derrière lequel on peut trouver tout et n’importe quoi. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement populiste, mais beaucoup plus sympathique que d’autres car il abritait beaucoup de revendications sociales et démocratiques. Je le vois donc plutôt d’un bon œil mais sa capacité de déboucher en politique est très faible car quelques revendications ne font pas une politique. Je crois donc qu’il faut éviter le populisme et lui répondre sans attendre un sauveur populiste de gauche. Tout populisme me paraît globalement vain.
VdH : S’il devait y avoir une issue politique aux Gilets jaunes, justement, la normalisation du mouvement ne le viderait-elle de sa substance ?

D.C. : Le Rassemblement national a essayé de récupérer les Gilets jaunes, la France Insoumise aussi. À sa façon, Michel Onfray et sa nouvelle revue essayent également, bien que leur projet ne soit pas très clair. Lorsqu’on récupère un mouvement, on lui donne une consistance politique mais cela ne sera jamais le « mouvement des Gilets jaunes » et ça ne pourra pas l’être. En récupérant un objet politique, on le transforme. En tant que tel, cet objet-là n’existe plus. Je constate, d’une part, que personne n’arrive réellement à récupérer les Gilets jaunes et que, d’autre part, si ça devait arriver, cela ne serait plus la même chose. Mais attention : la colère est toujours là. Celle-ci va s’exprimer de manières différentes, d’abord par l’abstention qu’il faut vraiment craindre. Elle peut aussi s’exprimer dans des partis populistes dont il n’y a pas lieu d’attendre un renouveau quelconque. Cela va surtout faire le jeu d’Emmanuel Macron et du pouvoir en place.
Et pourtant, l’expérience de Roosevelt aux États-Unis à un moment de crise importante, ou celle du Front populaire en France, ont montré que des partis implantés ont su, à un moment donné, se réinventer et faire des propositions de rupture. Je crois davantage en cela et j’essaie, en tant qu’intellectuel, de trouver des idées pour irriguer l’offre politique actuelle. Macron lui-même, de son côté, traduit aussi un moment populiste en se présentant comme anti-système et en publiant un livre intitulé Révolution. Il n’est pas une réponse au populisme, qu’il a au contraire tendance à attiser. Il faudrait une politique de rupture construite, avec un véritable projet derrière. Sans cela, c’est à nouveau l’impasse.
VdH : Quel pourrait être le bon compromis pour répondre à des demandes légitimes de la population sans sombrer dans le populisme ?
D.C. : Je propose de rompre avec le néolibéralisme, c’est-à-dire avec l’idée que l’État est au service du marché. Pour répondre à la crise industrielle française, François Hollande avait décidé de faire le CICE puis le « Pacte de responsabilité ». Il avait mis sur la table plus de 40 milliards d’euros par an. Combien d’usines pouvait-on construire avec cette somme astronomique, équivalente à l’époque du déficit commercial français ? On aurait pu faire un plan d’investissement extraordinaire avec cet argent ! Cela montre bien que nos gouvernements sont persuadés que la seule manière de gérer le marché est de faire de l’incitation. Personne ne songe à placer cet argent pour, par exemple, construire une usine quitte à passer par un partenariat public-privé… Lorsque Louis XIV et Colbert ont décidé de construire le château de Versailles, ils n’ont pas demandé aux verriers vénitiens de fournir de quoi faire les vitres et les miroirs. Colbert les a fait construire en partenariat avec l’entreprise Saint-Gobain (aujourd’hui devenu leader mondial des verres !). L’idée était d’utiliser la commande publique comme levier pour créer de la production. Faire cela est efficace mais suppose de la volonté politique et avoir la théorie en tête. Nos dirigeants politiques réduisent l’économie au seul marché. L’idée qu’on puisse reprendre en main le marché pour conduire une politique économique leur est totalement sortie de l’esprit. La politique industrielle américaine s’est faite, par exemple, avec les dépenses militaires et la NASA. Il faut recourir à une dépense publique intelligente, pas à une mise en concurrence avec le monde entier.
« Nos dirigeants politiques réduisent l’économie au seul marché. L’idée qu’on puisse reprendre en main le marché pour conduire une politique économique leur est totalement sortie de l’esprit »
Si l’on met cela en avant et qu’on affiche ce projet, les contraintes européennes et internationales finiront par tomber d’elles-mêmes. Certains anti-européens, tel François Asselineau, disent que la France est enfermée dans la prison de l’Union européenne. C’est une vision simpliste des choses. Certes, il y a des traités et des contraintes, mais on n’a surtout aucune volonté, aucun projet politique pour contredire ces traités ou ces institutions. Le jour où un projet clair se dessine, on trouvera un moyen pour faire tomber les contraintes, j’en suis absolument persuadé. J’attends donc que quelqu’un décide et – plutôt que de donner de l’argent public pour inciter les entreprises – l’utilise pour rebâtir directement l’industrie sans attendre que ça tombe du ciel ! Encore une fois, cela ne veut pas dire supprimer le marché. Peut-être va-t-il falloir bousculer nos partenaires européens, peut-être même va-t-il falloir sortir de l’Union européenne… Mais cela ne peut venir qu’après avoir élaboré un vrai projet positif.
Entretien réalisé par visioconférence le 18 juin 2020.
Photo de couverture : Margot l’Hermite.
Finalement on s’aperçoit que c’estceux qui sont pour la sortie de l’U.E et de l’euro qui ont raison si on veut que les peuples soit libéré de l’exploitation capitaliste. Sortons de cette Europe capitaliste et de l’euro..
J’aimeJ’aime